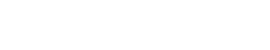Vivre dans le quartier du Port-à-l'Anglais
Le quartier le plus ancien de Vitry, avec le Centre-ville, est aussi un de ceux qui se développent le plus. Petit port sur la Seine dès le Moyen Âge, siège de nombreuses usines à partir du début du XXe siècle, le Port-à-l'Anglais ressemble à un village où les habitants se connaissent et perpétuent une vie sociale importante. Les aménagements urbains contemporains donnent un nouveau souffle au quartier, dont une partie était marquée par de nombreuses friches industrielles.
Petite histoire du quartier
L'histoire commence à être bien connue : pas de traces d'un Anglais dans ce quartier, mais plutôt d'un dénommé Langlois, ancien serf du chapitre Notre-Dame de Paris. Vers 1280, il installe une ferme et un port, qui devient le seul point de traversée du fleuve entre Paris et Corbeil jusqu'à la construction du pont de Choisy, en 1811.
Au Moyen Âge, les quelques habitations ne forment qu'un hameau en bord de Seine, relié au village de Vitry par un simple chemin.
Le trafic fluvial s'intensifie à partir de 1863, après la réalisation d'un barrage qui donne à la Seine la profondeur nécessaire pour être navigable toute l'année. En 1903, 140 bateaux franchissent tous les jours les deux écluses situées au niveau de la rue de Seine (actuelle avenue Salvador-Allende), là où sera ouvert le pont suspendu en 1928.
Le Port-à-l'Anglais – le nom est déformé depuis la Révolution française – va se développer avec la création d'une station de chemin de fer, en 1862, et la mise en service d'une ligne d'omnibus longeant la Seine, en 1867.
Après les premiers lotissements réalisés autour de la gare en 1884, l'urbanisation gagne les pâturages situés entre la rue Pasteur et la voie d'Amour (actuelle rue Édith-Cavell). Des rues sont percées (d'Algésiras, Vercingétorix, Duguesclin…), le groupe scolaire de Vitry-Port ouvre en 1895, un marché se développe place Charles-Fourier…
Les industries s'installent elles aussi au bord du fleuve :
- les établissements Chalumeau (blanchiment de tissus par le chlore) dès 1854, une fabrique de couvertures et sa teinturerie en 1867 (rue Constantin),
- la papeterie Bouilly-Lecomte en 1902 (elle laissera la place, en 1954, à l'usine Sciaky, qui produit des machines à souder les métaux),
- la centrale électrique Thomson en 1907-1908,
- un dépôt d'hydrocarbures,
- une manufacture d'acide sulfurique,
- une fabrique d'engrais,
- une usine de savons rue Waldeck-Rousseau
- et la Pelleterie de la Seine, qui traite les peaux de lapins, et dont les locaux seront ensuite occupés par Procimacfi (fabrique d'appareils d'alimentation des locomotives)…
Au tout début du XXe siècle, le Port-à-l'Anglais est un hameau quasiment autonome et presque aussi important que le vieux bourg : en 1905, on compte 1 100 électeurs dans le quartier de la gare et 1 600 dans le centre. Du fait de leur éloignement, les deux quartiers ont leur propre bureau de vote, leur école, leur marché, leur fête…
Leur liaison devient une nécessité pour les élus et l'avenue du Chemin-de-Fer, qui n'est alors n'est qu'une voie à travers champs, est peu à peu urbanisée. En 1925, sous le mandat de Pierre Périé, pharmacien originaire du Port-à-l'Anglais et premier maire communiste de Vitry, les deux pôles sont réunis en une seule entité urbaine.
La crise économique des années soixante-dix/quatre-vingt touche durement le quartier, qui voit ses entreprises fermer les unes après les autres. Il faut attendre la fin du XXe siècle pour que de nouveaux projets d'aménagement soient conçus sur les friches industrielles.
Avec la zone d'aménagement concerté du Port-à-l'Anglais, achevée en 2011, le quartier a entamé sa mue : 340 nouveaux logements, une halte-garderie, des rues prolongées jusqu'à la Seine, une voie créée (Aimé-Césaire), le square Charles-Fourier agrandi…
Plus au nord, sur l'ancien site Sciaky, l'opération Docks a permis de créer trois nouvelles rues (Rosa-Parks, Marguerite-Duras, Saint-Simon), 500 logements (en cours) et des locaux d'activité (Areva, groupe Casino…).
C'est au tour de la partie sud du quartier d'être entièrement repensée dans le cadre de la ZAC Seine-Gare-Vitry, qui prévoit 1 400 logements, un collège, une école, des locaux d'activité et le passage du T Zen, qui reliera la bibliothèque François-Mitterrand à Choisy-le-Roi…
Événements
1866 : Port-à-l'Anglais plage
Une rue de la Baignade au Port-à-l'Anglais ? Loin d'être une idée farfelue, cette appellation rappelle bien des souvenirs aux anciens du quartier. Dès 1866, on relève la présence de quelques cabines de plage à la limite de Vitry et d'Ivry. La baignade publique devient d'ailleurs un établissement intercommunal à partir de 1922.
À Vitry, le Club athlétique pratique la natation depuis 1897, tout comme, à partir de 1904, l'association Neptune Vitry-Port. La baignade est alors payante : on y loue des maillots de bain, on se change dans une quarantaine de cabines, on fait ses premières brasses avec l'aide de maîtres nageurs, on se repose sur le sable acheminé chaque année et on boit un verre à la buvette ! Deux bassins sont délimités – un grand et un petit – et les baigneurs peuvent sauter d'un plongeoir.
L'activité de la baignade prend fin en 1965. La Seine est de plus en plus polluée, la ville d'Ivry a ouvert une piscine en 1962 et Vitry s'apprête à construire deux bassins scolaires et une piscine municipale, inaugurée le 18 octobre 1969.
23 janvier 1910 : Crue centennale, la Seine déborde
L'hiver 1909-1910 est doux, les pluies abondantes et le niveau de la Seine monte de jour en jour. Le 23 janvier, la plaine de Vitry est inondée ; rue d'Algésiras, l'eau atteint le premier étage.
Trois jours plus tard, la voie de chemin de fer est coupée, la Seine déborde jusqu'à l'église Saint-Germain. C'est la catastrophe : 1 500 logements sont détruits, 8 000 habitants se retrouvent sans abri, l'usine électrique Thomson est à l'arrêt pendant deux mois et, avec elle, de nombreuses lignes de tramway…
Le 3 février, alors que commence la décrue, on circule encore en bateau dans les rues de Vitry.
> Le plan risque inondation
Au fil des rues
- Anoues (passage des) : relatif aux noues, terres grasses et humides ?
- Marguerite-Duras (rue) : la romancière et cinéaste a tourné à Vitry son dernier film (Les Enfants, 1984), et y a situé l'action de la Pluie d'été, le roman issu du film (1990).
- Halage (chemin de) : les péniches et coches d'eau étaient halés par des chevaux le long des chemins de… halage. Depuis le XVIe siècle, les coches d'eau transportaient les voyageurs. Ils ont été remplacés par des bateaux à vapeur à partir de 1830.
- Éva-Salmon (rue et école) : résistante vitriote, arrêtée par la Gestapo le 23 mars 1943 et morte en déportation en janvier 1945.
A découvrir
- Halle SNCF, 13, rue Pierre-Sémard : ancienne halle de marchandises construite en 1860. Elle est occupée depuis 1998 par Gare au théâtre.
- Habitation, 1-3, avenue Anatole-France : demeure construite en 1889. Juste à côté, rue d'Ivry, se trouvait le cinéma le Casino, aujourd'hui remplacé par un petit immeuble de bureaux. Cette salle de 800 places a été en activité de 1913 à 1973.
- Immeuble, 5, avenue Anatole-France : en rez-de-chaussée de cet immeuble construit à la fin du XIXe siècle, se trouvait un café limonadier. En 1907, son patron, M. Sezestre, a été autorisé par le préfet de police à donner des séances de cinématographie, les jeudis, dimanches et jours de fête.
- Chapelle Saint-Marcel, 78, avenue Anatole-France : chapelle et presbytère construits en 1935.
- Immeuble "Aux lilas", 14, rue d'Ivry : maison individuelle construite à la fin du XIXe siècle et transformée en immeuble en 1912. Son appellation évoque la culture du lilas, l'une des principales activités agricoles de la commune.
- École élémentaire Montesquieu, 57, rue Charles-Fourier : ouverte en 1895, l'école du Port-à-l'Anglais ou de Vitry-Port, selon les appellations, a été surélevée (1900) et agrandie (1915), avant d'être entièrement réhabilitée et de nouveau agrandie en 2012. Un peu plus loin dans la rue, la maternelle Éva-Salmon, en cours de construction, ouvrira ses portes pour la rentrée 2017.
- Halle Dumeste, 84-86, rue Pasteur : édifice de l'ancienne papeterie Bouilly-Lecomte (1902), vendue en 1939 aux établissements Sibille, puis à l'entreprise Dumeste qui fermera en 2004. Elle sera rénovée dans le cadre de l'opération d'aménagement des Docks.
- Pont du Port-à-l'Anglais : réclamée par les communes riveraines de la Seine depuis la fin du XIXesiècle, la construction du pont ne débute qu'en 1912, à la suite d'un concours ouvert à tout types d'ouvrages. Le projet lauréat reprend le principe des ponts suspendus mis au point par Albert Gisclard : des pièces de fonderie, placées aux extrémités et aux intersections des câbles, forment un système indéformable de triangles et de polygones qui donnent à l'ensemble une grande rigidité. Interrompu par la Première Guerre mondiale, le chantier ne sera achevé qu'en 1928.
Services publics
Etablissements scolaires
Page publiée le 23 avril 2016 - Mise à jour le 19 février 2025