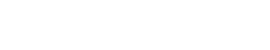100 ans du centre municipal de santé
Publiée le 17 février 2025 - Mise à jour le 24 février 2025
 Années soixante - Séance d’électrocardiogramme au dispensaire municipal. © Archives municipales
Années soixante - Séance d’électrocardiogramme au dispensaire municipal. © Archives municipalesEn créant un dispensaire municipal en 1925, la nouvelle majorité, issue d’une liste ouvrière, ouvrait l’accès aux soins aux habitants démunis. Vitry a ainsi inventé un équipement qui a inspiré nombre d’autres villes. Cette création s’avéra capable de durer, de se transformer, jusqu’à devenir l’actuel centre municipal de santé Pierre-Rouquès. Une structure forte d’une offre médicale et paramédicale complète, avec des d’équipements de pointe, proposée en tiers-payant.
En 1925, se soigner à Vitry n’est pas chose aisée. À cette époque, la ville a mué rapidement de bourgade agricole en ville ouvrière. L’eau courante rare, les rues non bitumées et boueuses et l’évacuation hasardeuse des déchets sont propices aux infections : tuberculose pulmonaire, diphtérie… Les rares médecins de ville sont souvent trop chers pour la population, le plus souvent de condition modeste, et les hôpitaux les plus proches se situent à Paris.
Or, cette année-là, une liste municipale portant les aspirations de la population ouvrière de la ville remporte les élections. Le nouveau maire, Pierre Périé, est pharmacien. Priorité à la santé ! Un jeune docteur de Vitry, Robert-Henri Hazemann, futur chef de cabinet du ministre de la Santé du Front populaire, est nommé à la tête du bureau d’Hygiène communal. Chiffres et études à l’appui, il prône la création d’un centre accessible aux habitants démunis, associant soins, dépistage et prévention.
Le 5 juillet, le conseil municipal vote la création d’un dispensaire, soulignant “la nécessité d’un Dispensaire Public où la population de Vitry pourra profiter de consultations et de soins qu’elle ne trouve actuellement qu’à Paris”. La commune acquiert une propriété au 10, rue Montebello, et l’équipe d’une unité de radiologie pulmonaire, d’un laboratoire de bactériologie et de services de consultations (nourrissons, enfants, accidentés du travail…). En 1926, le centre est opérationnel.
Au bénéfice des plus précaires
Pour y accéder, les patients peuvent, selon leur situation de précarité, disposer d’une carte rouge (consultations, visites de médecin et médicaments gratuits), jaune (consultations et médicaments gratuits) ou bleue (consultations gratuites). Un acte médical coûte 4,50 francs contre 20 francs en ville. Une concurrence plutôt bien acceptée par les médecins de ville, tant il est admis que les patients du dispensaire n’auraient pas les moyens de consulter autrement. Des initiatives similaires, inspirées du centre de Vitry, sont menées dans d’autres banlieues.
En 1929, le dispensaire est doté... d’une plage artificielle pour stimuler la croissance des enfants chétifs. On croit alors beaucoup à l’exposition au soleil pour se soigner. Dans une salle recouverte de sable, avec peinture bronze-aluminium aux murs, des rayons ultraviolets et infrarouges sont diffusés. “On nous mettait des lunettes et on jouait dans une chambre avec du sable très fin”, se rappelaient les jumelles Paulette et Yvonne, nées en 1924, dans Vitry le Mensuel de novembre 2007. Le dispensaire grandit. De 21 000 actes médicaux en 1930, il passe à 100 000 en 1966 !
En 1931, il déménage au 12, rue de Cussy puis, en 1955, à l’angle Henri-Barbusse/Montebello. Avec quarante médecins, il propose alors radiologie, soins et prothèses dentaires, rhumatologie, cardiologie… et se nomme désormais centre municipal de santé (CMS) Pierre-Rouquès, du nom du chirurgien à l’origine d’une douzaine de CMS dans l’est francilien.
Une offre médicale développée.
Entre temps, en 1945, un organisme national a été créé pour prendre en charge les soins médicaux : la Sécurité sociale. Le CMS reste essentiel : il propose une offre locale complète de soins médicaux, sans frais à avancer pour les patients grâce au tiers-payant. La création progressive d’autres structures de santé sur la ville – protection maternelle et infantile (PMI), centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), centre de planification familiale, clinique des Noriets – ne lui ôte pas non plus son attrait. Il continue de se déployer en suivant les évolutions techniques et les besoins de la population (mammographie, dépistage du sida, orthodontie…).
En 1995, il enregistre 65 000 consultations, dont 13 000 au service dentaire ! En 2007, la ville finance entièrement – à hauteur de 8 millions d’euros – un nouveau bâtiment, moderne et aux normes environnementales, accessible aux personnes à mobilité réduite, avenue du Général-de-Gaulle. La surface est doublée. Fort d’un laboratoire d’analyses, de dix-huit spécialités médicales et paramédicales (kinésithérapie), d’équipements de pointe, accueillant les consultations de garde du Sami, il vient en plus d’être doté d’un nouveau système de radiologie numérique.
Dans notre monde à évolutions rapides, qui sait à quelles mutations futures il est encore voué ?
Naï Asmar-Makni